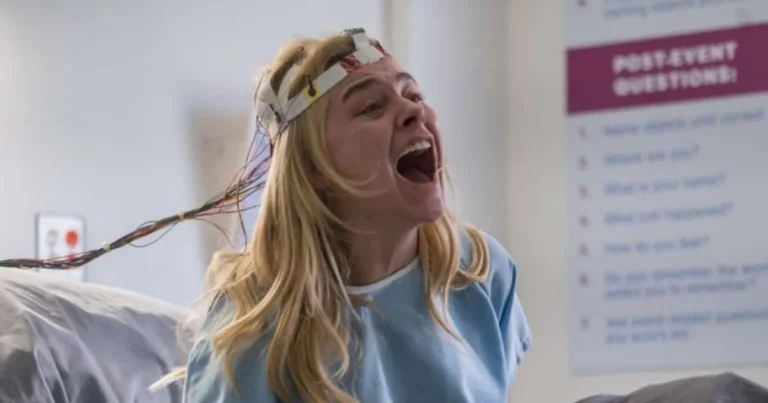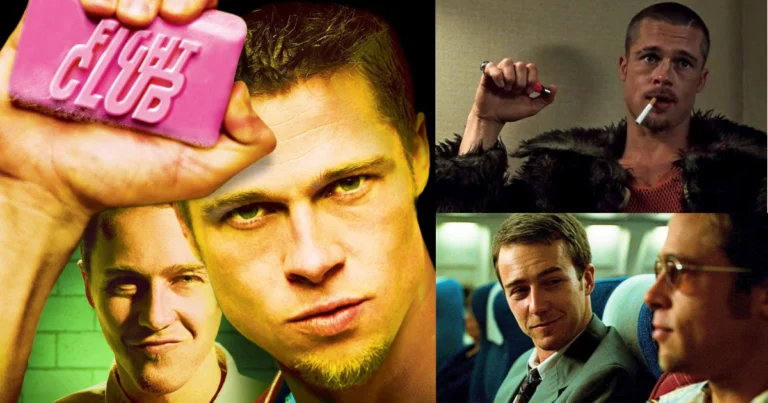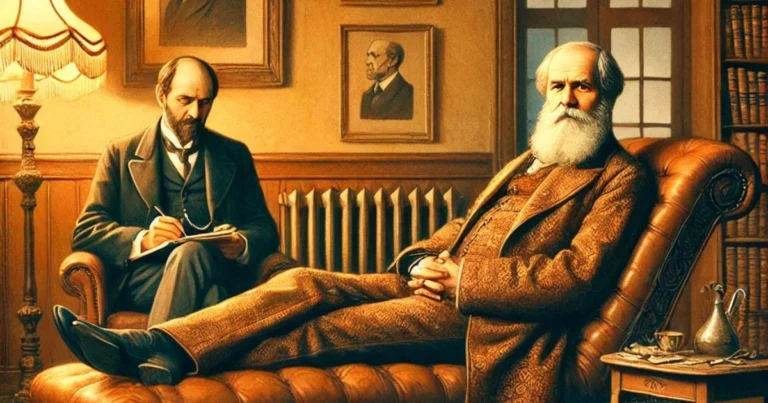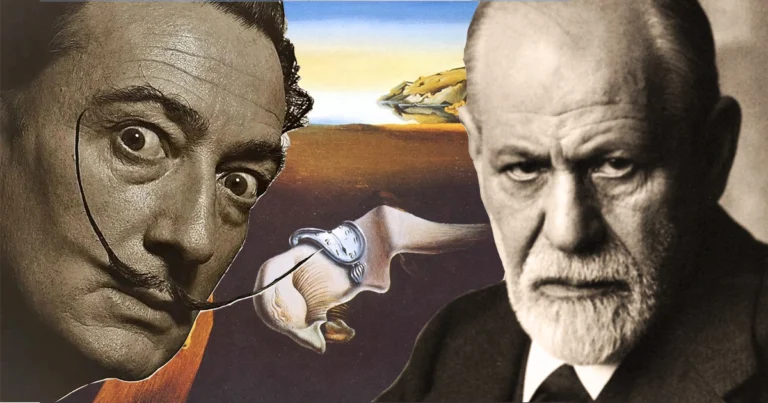Au royaume de la peur de Stanley Kubrick
Depuis que le cinéma est devenu l’art le plus populaire de nos jours, la peur et le cinéma ont scellé un pacte d’alliance éternelle. Dans son film « The shining » Kubrick, le roi du cinéma de la peur,nous invite à vivre une nouvelle aventure qui nous fera remonter les peurs que nous avons dans notre subconscient.
Quand on a demandé à Martin Scorsese ce qu’il pensait du cinéma de Stanley Kubrick il a répondu : « Regarder un film de Kubrick, c’est comme regarder le sommet d’une montagne depuis la vallée. On se demande comment quelqu’un a pu monter si haut ».
Durant sa carrière Kubrick a réalisé 13 longs métrages s’étalant sur plus de 45 ans, tous ces films ont reçu les pires critiques lors de leurs sorties, avant de devenir par la suite des classiques de cinéma, quatre de ses films sont classés dans le top 100 de l’American Film Institute.
Derrière le génie cinématographique de l’homme se cache un esprit ultra perfectionniste, tous ceux qui l’ont côtoyé ou ont travaillé avec lui témoignent de cette rigueur excessive qu’il adopte dans la direction de ses films, pour “ORANGE MÉCANIQUE“ l’acteur Malcolm McDowell s’est vu faire et refaire une prise plus de 50 fois, il déclara que les 7 mois de tournage était pour lui un véritable enfer. Il n’était pas le seul acteur d’ailleurs à croiser le chemin du perfectionnisme kubrickien, lors du tournage du film “THE SHINING“, l’actrice Shelley Duvall qui jouait le rôle de Wendy, confia aux journalistes que si c’était à refaire elle ne travaillerait plus avec Kubrick, notant que dans le tournage de ce film, Kubrick l’obligeait à répéter certaines scènes plus de 40 fois, et comme encouragement il lui martelait à l’oreille : « On n’a jamais rien obtenu de grand sans souffrance ».
Les équipes techniques qui ont travaillé avec Kubrick n’ont pas échappé aux caprices du réalisateur. Nombreux ceux qui ont souffert de la manie de l’homme pour les détails, à titre d’exemple, on rapporte que Kubrick a demandé à voir plus de 2000 fauteuils avant d’en choisir un pour le film “2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE“, il avait la fâcheuse tendance de vouloir tout contrôler, d’ailleurs le décorateur de 2001 a confié à propos du réalisateur : « Stanley est un homme extrêmement difficile et talentueux. Nous avons développé des rapports très étroits et le résultat est que je dois vivre sous tranquillisants ».
Pour son premier long métrage “ FEAR AND DESIRE “, tourné en 1953, Kubrick a détruit toutes les bobines qu’il a trouvé du film, pour finir par la suite par interdire toute projection. Il déclara à propos de ce film que c’est un : « exercice cafouilleux d’amateur », cela témoigne de l’ampleur du perfectionnisme du cinéaste, et à ceux qui l’interrogeaient sur son perfectionnisme maniaque, Kubrick répondait ainsi : « Si Napoléon n’avait pas dirigé ses troupes de façon précise, il ne les aurait jamais menées dans la bonne ville, le bon jour ».
Talentueuse est despotique tel est la volonté de puissance qui apparaît dans les œuvres de Kubrick, mais dans l’envers du décor, c’est un homme à la timidité presque maladive qu’on trouve, il supporte mal le regard d’autrui, vit en retrait de la société cloitré dans un manoir dans les régions de Londres, ne sortant que très rarement, ce qui lui a valu le titre d’Howard Hughes des réalisateurs.
Le Shining selon King
En 1980, Kubrick s’essaye à un nouveau genre cinématographique, il réalise pour le grand écran “ THE SHINING “ qui est devenu par la suite l’un des grands classiques du cinéma d’horreur.
Le film est une adaptation du roman “ SHINING, L’enfant lumière “ publié en 1977 par le nouveau auteur en vogue à l’époque Stephen King.
Dans le roman, Jack Torrance ancien professeur et ancien alcoolique, se voit proposé un poste de gardien pour l’hiver à l’hôtel Overlook dans les montagnes du Colorado. Il croit tenir là une chance de se racheter aux yeux de sa famille, en espérant profiter de cette occasion pour écrire la pièce de théâtre qui le révélera au monde, son fils Dany possède le don de medium “ Le Shining “, il voit grâce à ce don les esprits qui hantent l’hôtel et les atrocités qui y sont passés, petit à petit l’esprit de l’Overlook s’empare de Jack qui devient l’instrument de mal de l’hôtel tentant de tuer son fils et sa femme. Muni du Shining, le petit Dany aidé de sa maman et du cuisinier de l’hôtel Dick Hallorann, qui possède le même don que l’enfant, va lutter contre les forces du mal de l’hôtel pour mettre fin à ses esprits maléfiques et à Jack Torrance devenu démoniaque.
Le Shining selon Kubrick
Quand Stanley Kubrick s’empare du roman de King, il travaille d’arrache pieds avec la romancière et scénariste Diane Johnson, pour adapter l’histoire à sa vision, ce qui ressort de cette collaboration déplait énormément à Stephen King qui trouve que le réalisateur a trahi son œuvre.
Pour la réalisation de SHINING Kubrick à balayer tous les standards connus jusqu’alors dans le genre du film d’horreur, les séquences gore sont écartées du script, et plusieurs scènes qui ne correspondaient pas à sa vision sont supprimés, notamment la fameuse scène finale, où dans le roman la chaudière, qui symbolise le cœur du mal de l’Hôtel Overclock, explose mettant fin à la vie de Jack et aux forces du mal. Cette fin classique et conventionnelle des films d’horreur, est loin de plaire à Kubrick. On trouve une allusion à cela dans même le film, à savoir la scène d’interview qu’a eu Jack avec le directeur d’hôtel quand celui-ci lui dit qu’il faut faire tourner la chaudière régulièrement, Jack répond avec un sourire évocateur : « tout ça me parait bien faisable ». Ce clin d’œil de Kubrick est probablement sa maniéré de dire que réaliser un film d’horreur traditionnel est tout à fait à sa portée, mais ce n’est pas ce qu’il recherche à travers ce film, d’ailleurs la mort de Jack dans le film est à l’opposé de sa mort dans le roman, c’est sous le froid et la glace que sa mort s’opère dans le film, tandis que c’est sous un feu spectaculaire qu’elle se manifeste dans le roman.
Si Kubrick procède à de tel maniement dans le script ce n’est pas par esprit capricieux ou animosité envers Stephen King, il s’agit plutôt de sa philosophie et de sa manière de voir le monde, en d’autres termes le cinéma selon Kubrick. Une vision pragmatique le guide dans le récit, aucun flashback ne vient entraver le récit linéaire pour expliquer le passé alcoolique de Jack comme dans le roman, refusant ainsi l’approche freudienne, ne donnant par là aucune origine psychique antérieur, au mal qui range Torrance.
Le style de Kubrick dans “ SHINING “ s’éloigne des standards du film d’horreur.
Au niveau lumière, la majorité des scènes se déroulent en lumière du jour, Kubrick préfère ne pas jouer sur les images obscurs pour attiser la peur, il privilégie à cela une image claire est froide. Dans le même esprit on remarque l’absence des plans avec effet de surprise tant connus dans les films d’horreur, au contraire le film adopte un rythme nonchalant et serein, c’est presque de l’hypnotique. On s’insère petit à petit dans le monde de Jack, tandis que lui sombre dans les méandres de ses propres déments, la peur qu’on ressent ici n’est pas la peur rituelle des films du genre, il s’agit plutôt d’une angoisse permanente et froide sans éclaboussure, à l’image de celle qu’on trouve dans la Métamorphose de Kafka, qui était d’ailleurs l’un des auteurs et inspirateurs majeur du cinéaste pour ce film.
Labyrinthe, Mythologie et Contes de fées
Dans Shining, l’espace se construit autour de plusieurs labyrinthes, le premier est celui qui fait office de jardin à l’extérieur de l’hôtel, là où jouait Dany et sa maman, celui de la scène finale avec Jack poursuivant son fils avec une hache. Le second labyrinthe est la maquette de ce jardin, celle qui se trouve à l’intérieur de l’hôtel, les longs couloirs distribuant les chambres sont aussi filmés comme un chemin sinueux renforçant la sensation de vertige, pareil pour la grande cuisine de l’hôtel que Wendy perçoit comme un labyrinthe d’où elle ne pourra pas sortir, sans oublier la fameuse moquette avec des motifs quasi hallucinogènes.
Le labyrinthe dans le film transcende à son rôle d’espace, il est la projection de l’esprit, espace et esprit sont par ce biais étroitement liés. Un exemple de cet relation espace-esprit peut se lire dans la scène où Dany se faufile avec sa tricyclette dans les couloirs de l’Overloock comme s’il parcourait l’inconscient de son père, entre labyrinthe intérieur psychique et labyrinthe extérieur physique. La question du mal se pose, est-il intrinsèque à l’homme ou bien, c’est le monde qui le façonne à son image, est-ce l’hôtel qui possède Jack, ou est-ce Jack qui projette ses démences sur l’hôtel.
Gilles Deleuze parlant du cinéma de Kubrick écrit : « chez Kubrick, le monde lui-même est un cerveau, il y a identité du cerveau et du monde, tel la grande table circulaire et lumineuse de Docteur Folamour, l’ordinateur géant de 2001, l’odyssée de l’espace, l’hôtel Overlook de Shining », il rajoute : « dans Shining, comment décider de ce qui vient du dedans et de ce qui vient du dehors, perceptions extrasensorielles ou projections hallucinatoires ? ».
La mythologie aussi est un thème prépondérant dans The Shining, plusieurs références y sont visibles. La plus dominante étant la légende du minotaure qu’on voit sous-jacente à travers les labyrinthes psychiques et physiques, la scène de Wendy dans la cuisine y fait allusion quand elle dit au cuisinier : « tout cet endroit est un si énorme labyrinthe qu’il me faudra tracer une piste de miette de pain chaque fois que j’y rentrerais », faisant rappeler par-là Ariane et son fil dans la légende du minotaure.
Les contes de fées occupent aussi une place importante dans le scénario, Le Petit Poucet, Les Trois Petits Cochons et Barbe Bleu sont parsemés à travers l’histoire, revisités par Kubrick ils ont donné à ses personnages une dimension fantasmagorique, d’ailleurs durant la préparation de son film, Kubrick s’est penché sur plusieurs lecture, entre autre, le célèbre livre « Psychanalyse des Contes de Fées », de Bruno Bettelheim.
Regarder un film de Kubrick est un exercice bien laborieux, ses œuvres ne livrent pas leurs secrets facilement, tous les détails chez Kubrick ont une justification vue le penchant perfectionniste de l’homme, alors une synthèse qui a pour ambition l’un de ses films, restera toujours incomplète, d’autant plus qu’une œuvre artistique quelle qu’elle soit, ne se réalise pleinement qu’à travers des lectures subjectives, lui donnant ainsi un visage toujours changeant.
En conclusion, l’œuvre de Kubrick échappe à toute tentative d’analyse définitive. Par son exigence artistique et sa maîtrise du détail, il a créé des films qui transcendent le temps et continuent de fasciner. Ils ne se consomment pas, ils se méditent, offrant à chacun une expérience profondément personnelle. C’est précisément cette richesse et cette complexité qui font de ses films des chefs-d’œuvre inépuisables, où chaque regard renouvelle le mystère.
Références :
Ciment, M. (2004). Kubrick. Paris : Calmann-Lévy.
Deleuze, G. (1985). L’image-temps : Cinéma 2. Paris : Collection Critique.
Réalisateur
Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.
License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.
DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.